À en juger par la progression continue de l’abstention aux municipales, les villes deviennent des déserts démocratiques. À en juger par le taux de participation aux élections, seulement… Car sur le terrain, des militants politiques, associatifs et syndicaux continuent de faire de la politique, au sens noble du terme. Parmi eux : le Toulousain Salah Amokrane, qui défend avec fougue un avenir plus radieux pour les habitants des quartiers populaires.
À travers Vitécri puis le Tactikollectif, l’ex-leader des Motivésse bat sans relâche pour redonner du pouvoir aux citoyens. Il mène un travail de fourmi pour aider les plus exclus ou démunis à prendre la parole sans avoir à rougir de leur histoire, et transformer leurs ras‐le‐bol en revendications politiques. Face au renforcement de la ségrégation sociale, le principal représentant politique de Zebda incite également les associations de proximité à s’émanciper de leurs tutelles politiques afin d’influer davantage sur la vie publique locale. Et les élus, de leur côté, à libérer et associer plus étroitement ces viviers de la démocratie locale. L’engagement civique de Salah Amokrane est total. Loin, très loin, de la politique politicienne.
Tête de liste des « Motivé‐e‑s » lors des municipales 2001 à Toulouse, vous vous inscriviez déjà à l’époque dans une démarche participative et citoyenne, devenue tendance en 2020. Quel regard portez‐vous sur les dernières élections ?
Notre initiative a marqué les esprits, mais nous n’avions fait en réalité que nous inspirer d’expériences passées. Je songe en particulier aux « groupes d’action municipale » ayant conduit Hubert Dubedout à la tête de la mairie de Grenoble en 1965. Dans les deux cas, l’idée consistait à répondre à une demande citoyenne, non pourvue par l’offre politique traditionnellement présentée aux électeurs. Près de vingt ans après les Motivé‐e‑s, on retrouve toujours – un peu partout en France – cette même attente visant à donner plus d’écho à l’expertise d’usage des habitants. Ça me laisse quelque peu perplexe…
Qu’inspire au Toulousain engagé que vous êtes la percée, justement, réalisée par l’Archipel Citoyen en 2020, à deux doigts de ravir le Capitole ?
Nous partagions – les Motivés et l’Archipel citoyen – un même constat démocratique, celui de la trop faible place accordée à la parole des habitants. Quand bien même nous n’avions pas à rougir de notre score en 2001 (12,4%), eux ont réussi l’exploit de devancer les partis de gauche classiques lors du premier tour des municipales à Toulouse en recueillant 27,6% des voix.
Mais les questions de méthodologie – tirage au sort, implication de volontaires non‐encartés, indépendance vis‐à‐vis des formations politiques – ont pris une place considérable à mon goût. Ces idées novatrices méritaient d’être mises en avant, bien sûr, mais pas au point de devenir l’alpha et l’oméga de la campagne d’Archipel. Le plus important pour la majorité des électeurs, notamment ceux du Mirail ou d’autres quartiers populaires, ça reste le projet politique pour la ville !
Que voulez‐vous dire ? Les colistiers d’Archipel ont‐ils trop parlé de « fin du monde » et pas assez de « fin du mois » ?
En partie oui, aussi, mais je ne veux pas me poser en donneur de leçons. Croyez‐moi, si j’avais eu la recette, les Motivés auraient gagné en 2001 et je ne me serais pas gêné pour repartir en 2020… Sans tomber dans l’excès d’« United Colors of Benetton », il aurait pu être intéressant de présenter une liste représentant les différentes franges de la population toulousaine. Ce biais sociologique a pu, en l’état, influer sur les grandes orientations et omissions de la campagne.
Les colistiers d’Archipel préalablement investis sur l’écologie (à commencer par la tête de liste Antoine Maurice, NDLR), ont porté avec aisance ces sujets stratégiques dans la campagne. Idem pour les professeurs ou les travailleurs sociaux qui ont su défendre l’utilité des services publics. Mais il manquait probablement une poignée d’habitants des quartiers populaires, capables de faire campagne sur la lutte contre les inégalités sociales et les discriminations raciales. Dès lors que la question sociale ne semblait pas au cœur du projet d’Archipel, difficile ensuite de demander aux classes populaires de se déplacer pour voter pour eux !
Au‐delà de Toulouse, les millions d’arbres promis par des candidats appartenant essentiellement aux classes moyennes et supérieures ont‐elles pu cacher la forêt de pauvreté existant dans ou en marge de nos villes ?
Très peu, trop peu de candidats se sont emparés des inégalités, qui se sont particulièrement révélées pendant l’épidémie. La thématique avait déjà été peu abordée avant le premier tour, mais c’est à se demander si cela n’a pas viré à l’impensé durant l’entre-deux tours, à Toulouse comme dans d’autres grandes villes de France. Comme si la gauche, consciente de la difficulté à mobiliser les classes populaires, avait décidé d’arrêter de se casser la tête avec les quartiers pauvres…
Tout comme le mouvement écologiste a su imposer l’environnement dans les débats, il faudra faire demain de la cohésion sociale une véritable question politique. D’un quartier à l’autre, vous n’avez parfois pas l’impression de vivre dans la même ville ! Bien que n’étant pas franchement sensible aux aspirations communautaristes, j’ose espérer que les choses évolueront avec le renouvellement du personnel politique municipal. Plusieurs maires issus des quartiers populaires et engagés sur ces questions ont été élus en 2020 à Givors, Saint‐Ouen, Trappes ou encore Villejuif.
« Le fossé entre centres‐villes et quartiers populaires, que nous disons vouloir combler, s’élargit chaque jour un peu plus »
Mis à part peut‐être ces quelques mairies, l’après-Covid ne changera donc pas grand‐chose pour les « invisibles » des quartiers populaires ?
Comme beaucoup, j’ai un temps pu espérer qu’il en soit autrement. Il y a eu une prise de conscience au début du confinement sur l’importance du rôle des « premiers de corvée », très utiles au fonctionnement de notre société et de nos villes ; les collectivités ont d’emblée soutenu des initiatives associatives et citoyennes pour tenter d’amortir les chocs de la crise sociale. Je doute néanmoins, aujourd’hui, que tout cela débouche sur un changement de paradigme. Le fossé entre centres‐villes et quartiers populaires, que nous disons vouloir combler, s’élargit en réalité un peu plus chaque jour…
Que vous inspirent les records d’abstention atteints dans les quartiers populaires en 2020, après ceux déjà enregistrés en 2014 ?
La partie « sanitaire » de l’abstention ne peut être imputée ni à Archipel, ni à la gauche classique, ni aux autres partis. Soyons bien clairs là‐dessus. Cela dit, la défiance de la population vis‐à‐vis du personnel politique va, grandissant, depuis un certain temps. Et elle frappe Jean‐Luc Moudenc très mal réélu, autant que d’autres maires y compris écologistes et socialistes, ou même Emmanuel Macron, qui avait lui aussi été mal élu en 2017.
Lorsque vous voyez l’évolution urbaine de Toulouse et de certains quartiers comme Arnaud Bernard ou Borderouge, où j’habite, comment voulez‐vous que la majorité des Toulousains ne se sentent pas mis à l’écart ? Les promoteurs construisent de partout, les immeubles poussent à un rythme effréné…
Alain Damasio : « J’observe une privatisation croissante de nos villes »
Reste qu’on entend peu les habitants des quartiers populaires contester cette donne, que ce soit dans le mouvement des Gilets Jaunes, les associations environnementales ou les instances de démocratie participative…
Le déficit d’engagement dans la vie associative et politique est général ! Il ne concerne pas seulement les classes populaires ! Heureusement, des collectifs comme les femmes d’« Izards Attitude » parlent admirablement bien des préoccupations de la jeunesse de ces quartiers, de l’éducation, de l’écologie aussi – davantage au sens de l’accès à une alimentation de qualité ou de l’isolation des logements d’ailleurs, que de la lutte contre la pollution de l’air, moins concrète pour eux. Les élus soucieux de transformer les expériences du quotidien vécues par les habitants des quartiers populaires en propositions politiques pertinentes ne devraient pas hésiter à entrer davantage en contact avec ces têtes de pont. Ce sont des interlocuteurs tout à fait légitimes.
Les élus locaux ont‐ils seulement la capacité de « changer la vie » de leur population ?
Oui, je crois plus que jamais en la force du local ! Sans nier l’importance de l’État, c’est aux collectivités de réfléchir aux meilleures stratégies pour faire face au creusement de ces inégalités socio‐spatiales. Probablement, manque‐t‐il des moyens financiers aux élus municipaux et métropolitains, mais aussi peut‐être un peu de volonté ?
Je n’irais pas jusqu’à dire qu’ils ont fait l’autruche jusqu’ici, ce serait caricatural. Il y a des services publics, des centres sociaux dans les quartiers populaires de Toulouse, qui sont d’ailleurs desservis, pour la plupart, par le métro. Ce qu’il manque, à mes yeux, c’est surtout la reconnaissance du rôle essentiel joué par les acteurs de terrain, un soutien aux petites associations engagées en faveur d’une alimentation de qualité, de l’éducation et du soutien scolaire, de la dynamisation de l’espace public, dans le domaine sportif ou culturel, etc. Elles sont essentielles, aux côtés de l’école ou des familles, pour la construction des jeunes issus des classes populaires. Il faudrait créer bien plus de passerelles entre le monde associatif et le monde politique local.
« Face à l’échec de leurs politiques, les autorités ne pourraient‐elles pas entendre les revendications des habitants et expérimenter de nouvelles recettes ? »
Les collectivités ne font‐elles pas suffisamment confiance aux associations et aux habitants ?
Vu la déliquescence du tissu associatif, c’est évident que non ! Aux Izards à Toulouse, par exemple, les initiatives concrètes montées par divers collectifs d’habitants regroupant tantôt les jeunes, les Chibanis, les filles ou les garçons, ont été réduites à portion congrue en une vingtaine d’années à peine…
Une minorité pose peut‐être problème dans les quartiers populaires, je l’admets, mais les habitants sont aussi une partie de la solution. Prenez le trafic de stupéfiants, qui a transformé les Izards en supermarché toulousain de la drogue : ce fléau pourrit la vie de la majorité des habitants, fait des morts chez nos jeunes, etc… Si la prohibition et la répression fonctionnaient, je serais le premier à applaudir. Mais, face à l’échec de leur politique, les autorités ne pourraient‐elles pas entendre les revendications des habitants et expérimenter ensemble de nouvelles recettes comme la dépénalisation du cannabis ?
Les associations de quartiers peuvent‐elles contraindre les décideurs à mettre à l’agenda et traiter les problèmes auxquels les habitants font face ?
Elles le devraient. Lorsque vous êtes financé par de l’argent public au titre d’association de quartier, vous devez dire la réalité des quartiers et non pas cacher le désespoir de toute une partie de la population ! Si on s’en tient aux principes, il n’y a pas de risques : le droit à la subvention est inscrit dans la loi pour toutes les structures qui fournissent un service d’intérêt général. Sauf que dans les faits, certains responsables politiques vérifient vos prises de position avant de vous attribuer lesdites subventions… La frontière avec le clientélisme s’avère parfois mince.
De plus, rien dans la démocratie locale française n’oblige les maires ou les présidents de métropole à donner de l’autonomie à la société civile. Lorsque je siégeais au conseil municipal en tant qu’élu minoritaire (NDLR : de 2001 à 2008), Philippe Douste‐Blazy me répétait que son opposition, ce n’était pas moi mais l’opinion publique. Et je dois avouer qu’il n’avait pas totalement tort vu les droits et les moyens dont je disposais… Tout cela pour dire que les décideurs motivés par le bien‐être de leur population ne devraient pas craindre de générer des contre‐pouvoirs, qui sont plus que jamais nécessaires en démocratie.
Tribune – Comment la démocratie locale bâillonne les quartiers populaires
Mais le Tactikollectif, par exemple, ne semble pas vraiment s’autocensurer ni être sous la tutelle des politiques au pouvoir…
De par notre histoire et notre place dans la ville, nous ne nous sommes pas cachés à titre personnel de nos votes pour Archipel. Mais nous n’avons pas engagé le Tactikollectif – qui touche des subventions municipales pour certains projets d’intérêt général, comme le festival Origines Contrôlées – dans le débat électoral.
La dépendance financière de nombre de structures associatives aux subventions municipales, et donc aux collectivités, est un réel problème démocratique en France. Beaucoup se retrouvent coincées. Car derrière cet argent, il y a souvent des emplois en jeu… Ce problème n’est pas réductible à Toulouse ni à une question de gauche ou de droite. Je connais bien trop de camarades associatifs qui craignent de faire les frais, malheureusement, de désaccords ou de controverses avec des mairies administrées par le PS.
Que devraient changer les associations de terrain pour faire monter la pression populaire et être en capacité de mieux faire entendre et respecter les intérêts des habitants des quartiers ?
Le monde associatif doit faire son examen de conscience et tendre peut‐être davantage vers le financement participatif pour gagner en indépendance. Il faudrait d’abord prouver tout l’intérêt de nos interventions aux habitants, avant de chercher à montrer leur utilité aux quelques politiques qui les financent. C’est ainsi, et seulement ainsi, que les acteurs associatifs deviendront incontournables…
Je ne suis pas « bas‐iste » et ne dis pas que toutes les solutions viendront du terrain, mais je crois beaucoup à la coordination des associations de banlieues. Cessons de travailler chacun dans notre coin. Pourquoi ne pas accompagner les petits porteurs de projets associatifs dans les quartiers, sur le modèle de ce que proposaient hier les formations de jeunesse des partis ou les grandes fédérations d’éducation populaire ? Se former, c’est la seule manière pour les acteurs associatifs de se structurer et de monter en compétences, d’apprendre à nouer des rapports de force et d’être en capacité de régénérer le débat public local.
« La culture s’avère un vecteur déterminant pour faire le lien entre les mobilisations citoyennes et associatives d’un côté, et la politique institutionnelle de l’autre. »
Entre l’action de terrain et le combat politique, quelle est la meilleure voie, selon vous, pour jouer un rôle actif en faveur des plus pauvres ?
Les deux, mon général ! Ni les pratiques associatives ni les récits politiques ne suffisent, seuls, à changer les choses. Sur la question des violences policières ou du manque d’indépendance de l’Inspection générale de police nationale (IGPN), par exemple, je crois plus aujourd’hui en l’expertise développée par les groupes locaux du Comité Adama qu’en n’importe quel parti politique. Sans cette saine pression populaire, sans les larges manifestations du 2 juin devant le palais de Justice à Paris mais aussi rue Alsace‐Lorraine à Toulouse, le gouvernement n’aurait pas proscrit temporairement la clef d’étranglement… avant de céder sous la pression des syndicats de policiers et de revenir sur son choix.
Mettre en concurrence l’action auprès des habitants et celle du terrain électoral serait contre‐productif. Tout l’enjeu du moment, c’est de faire le lien entre les mobilisations citoyennes et associatives d’un côté, et la politique institutionnelle de l’autre. La culture s’avère, me semble‐t‐il, un vecteur déterminant pour articuler ces deux engagements.
« La culture, c’est aussi important que l’aménagement urbain »
L’histoire de Zebda et des Motivés, de Vitécri puis du Tactikollectif, c’est justement une histoire artistique mêlée à un engagement politique et associatif. Est‐ce plus facile de ré‐intéresser les citoyens aux transformations de la société et de la cité en les invitant à un festival ou un concert plutôt qu’à un meeting politique ?
Je ne sais pas si c’est plus efficace, mais c’est ce que nous avons toujours essayé de faire, et cela s’appelle, ni plus ni moins, l’éducation populaire ! La culture, ce n’est pas qu’un supplément d’âme destiné à danser et s’amuser, mais aussi un moyen de reprendre la parole et de transmettre notre vision, notre savoir !
Si Zebda, Vitécri et le Tactikollectif ont investi le terrain culturel, c’est avant tout faute de place laissée dans le champ politique. Lorsque Mustapha (dit « Mouss ») et Hakim organisent ensuite le festival « Origines Contrôlées » sur l’immigration maghrébine à Toulouse, il ne s’agit pas de revenir sur notre parcours ni de conter une histoire séparatiste, mais plutôt d’éviter de laisser à la droite dure et à l’extrême‐droite le soin d’écrire le récit de la Nation.
Le mélange de rap et de chanson populaire occitane promu par Zebda n’a‑t-il pas été davantage utile que la politique de la ville pour faire en sorte que les jeunes descendants d’immigrés du Mirail ou des Izards se sentent pleinement Toulousains et Français ?
Nous avons encore une chance de ne pas tomber dans le piège identitaire qui nous guette, mais ce qui est sûr, c’est que les discours creux et moralistes de SOS Racisme ne suffisent plus ! Plutôt que de répéter que « le racisme, c’est mal », nous devons donner à voir la réalité de la vie quotidienne dans les quartiers : ce n’est ni le paradis ni l’enfer dépeint par les médias, c’est un entre‐deux, entre « Les Talents des Cités » et le trafic de drogues, avec des choses qui vont bien et d’autres mal…
Il nous faut à tout prix sortir des échanges de principe totalement désincarnés sur l’immigration et l’intégration. C’était toute notre ambition avec l’exposition « Ô Blédi ! Ô Toulouse ! », consacrée à la présence des Maghrébins à Toulouse, et produite en partenariat avec la mairie. Nous souhaitions verser nos histoires diverses dans le pot commun, au même titre que Toulouse a été marquée par l’arrivée des Gitans et des Espagnols avant nous. Ce brassage est constitutif de la culture occitane.
Croyez‐vous possible de faire des mairies et des métropoles des laboratoires du renouveau politique et social ?
Oui, trois fois oui ! L’échelon local me semble déterminant pour repolitiser le débat public, et actualiser le récit national en y intégrant l’histoire des quartiers populaires et de leurs habitants. J’étais déjà très investi sur ces enjeux de mémoire dans l’espace public lorsque je siégeais au conseil municipal, surtout en faveur de la féminisation des noms de rues à l’époque.
Avec Zebda, les Motivés, le Tactikollectif, on a montré qu’on pouvait occuper l’espace public en s’appelant Salah, Mustapha ou Hakim, et obtenir des avancées concrètes. Je crois totalement dans la force du local pour régénérer la société française « par le bas. » La France est malade de son centralisme. Moi, Salah Amokrane, je suis français mais aussi toulousain, pas parisien ni lillois. Mon histoire, mon identité sont fortement marquées par la ville et le quartier où j’ai grandi. C’est Bernard Lavilliers qui disait dans « Le stéphanois » qu’ « on n’est pas d’un pays, mais on est d’une ville. »
Découvrez les autres grands entretiens de l’été sur Mediacités
Cette interview fait partie d’une série d’entretiens réalisés autour du thème “Le changement, c’est par le bas”.
1 – « La société civile doit s’organiser pour peser sur l’agenda municipal » (Guillaume Gourgues, chercheur en sciences politiques).
2 – « On ne gagnera jamais la bataille du logement sans travailler à l’échelle locale » (Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre)
3 – « Une politique pour le climat ne peut pas se limiter aux pistes cyclables et aux transports en commun » (Zoé Lavocat, responsable Territoires au sein du Réseau Action Climat)
4 – « Les municipalistes disposent désormais d’une vraie force d’expérimentation locale » (Elisabeth Dau, co‐présidente d’Action Commune)
5 – « L’économie a toujours évolué plus vite que la politique » (Thomas Huriez, 1083)
6 – Terres agricoles : « La volonté politique n’est pas assez forte pour stopper la frénésie de l’urbanisation » (Benjamin Duriez, Terres de Liens)

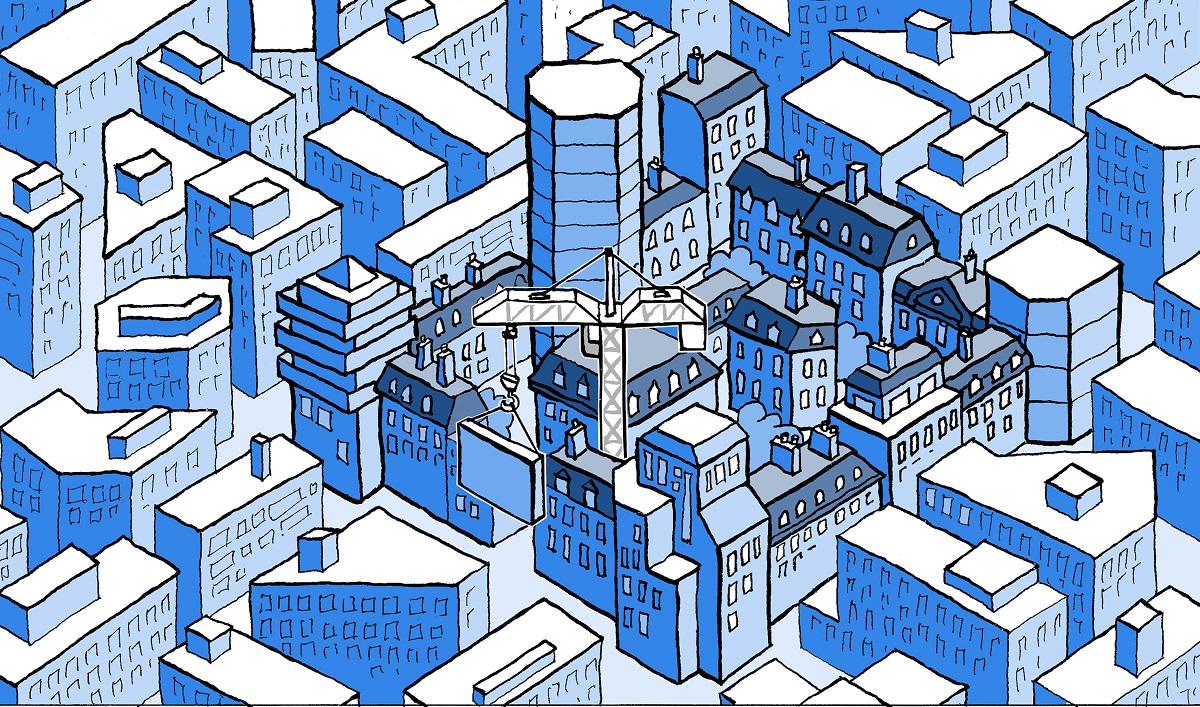
Il est bien gentil Salah mais il oublié de nettoyer ses lunettes quand il contemple le passé. Il a échoué. Il a bien participé au système réseautage et vieilles dentelles de
cette ville en se glissant dans les pantoufles brodées de » l’élite » locale.
Pour repolitiser le débat il faut avoir des idées politiques. Qui ne soient pas hors d’usage.
Salah s’est bien accommodé de la politique d’assignation de résidence et de destin telle que la droite baudisienne comme la gauche archeo socialiste et tous les affairistes locaux l’ont bétonnée sans jamais la remettre vraiment en question au moment de voter. Et je préfère me souvenir des Izards du temps où Zebda le grand, l’imaginatif, rassemblait toute la ville urbi et orbi avec la superbe Yvette Horner au cours dun méga banquet musette de feu au pied des barres d’immeubles. Les années 90 sont‐elles si loin que l’on ne puisse les rattraper ?
L’an dernier j’y suis revenue aux Izards pour une réunion dans l’école du coin. Méconnaissable le quartier de « ça bouge au Nord ». Je ne trouvais plus dans cette laideur ambiante ma route.
La boulangère qui m’a indiqué ma route : voilée pour ne pas heurter les sensibilités communautaristes sans doute .. .pourquoi pas non plus le costume de la vallée du Biros à la charcuterie ariegeoise ? Les chouffeurs sifflaient comme des merles parce que je cherchais mon chemin en arpentant la cité. Le territoire des caïds.
Et la cité elle n’appartient plus , les flics le savent bien, aux habitants de la République une et indivisible. Le ghetto s’est fermé à double tour sur l’impuissance des dogmes vidés de leur force. Comme ceux des antiques Motivés… si « motivés « que si j’en crois mon souvenir, ils n’ont jamais brillé en séance municipale.